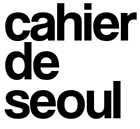Votre panier est vide.
À rebours de la société confucéenne et profondément patriarcale de la Corée du Sud, où les femmes ont longtemps occupé une position inférieure à celui des hommes, la province de Jeju-do a vu émerger sur ses terres volcaniques une communauté de pêcheuses fondée sur une organisation sociale de type matriarcal.
Située à 85 kilomètres au sud de la péninsule coréenne, l’île de Jeju est née de l’éruption du volcan Hallasan, aujourd’hui éteint. Son isolement insulaire et son climat subtropical en font aujourd’hui une destination de villégiature très prisée des Coréens, mais aussi des touristes japonais et chinois.

Les Haenyos, les femmes de la mer
Avant que le tourisme ne devienne le moteur principal de l’économie locale, l’île de Jeju-do a longtemps vécu au rythme de la mer. La pêche constituait la principale source de revenus des familles, et cette activité reposait presque exclusivement sur les femmes : les haenyeo, ces plongeuses hors du commun, récoltaient à mains nues les trésors des fonds marins.
Plongeant en apnée jusqu’à six heures par jour, sans bouteille ni combinaison, elles rapportaient ormeaux, poulpes, oursins et huîtres, qu’elles allaient chercher jusqu’à 15 mètres de profondeur. Grâce à leur entraînement, certaines sont capables de retenir leur souffle pendant près de deux minutes, défiant les limites du corps avec une endurance impressionnante.
À Jeju-do, la pêche est devenue, à partir du XIXe siècle, une activité essentiellement féminine pour deux raisons majeures. D’abord pour des motifs économiques : les pêcheurs hommes étaient lourdement taxés, ce qui rendait leur activité peu rentable, contrairement à celle des femmes, exonérées. Ensuite, pour des raisons physiologiques : le corps féminin, naturellement plus riche en graisse sous-cutanée, résiste mieux à la pression de l’eau et aux températures glacées de l’hiver, où la mer peut descendre jusqu’à 8 °C.
Ainsi, ce métier rude et périlleux a été assumé par les femmes, tandis que les hommes, relégués aux tâches domestiques, se retrouvaient en retrait de la vie économique. Cette dépendance de l’île à la pêche a conféré aux haenyeo un rôle central dans la cellule familiale, celui de cheffe de famille — un statut rare dans une société coréenne profondément patriarcale.
Pendant plus d’un siècle, chaque fille née dans un village de pêcheurs se destinait à devenir plongeuse. Elles apprenaient à nager dès l’âge de 7 ou 8 ans, puis devenaient haenyeo à 15 ou 16 ans, après plusieurs années d’apprentissage et d’acclimatation à la mer.
En 1950, on comptait près de 30 000 haenyeo sur l’île. L’ouverture du marché japonais aux produits de la mer de Jeju, à la fin des années 1970, marque une période de prospérité. Mais c’est aussi le début d’un lent déclin : les plongeuses préfèrent désormais scolariser leurs filles, leur offrant la possibilité de choisir des métiers moins éprouvants. Dans le même temps, l’industrie du tourisme commence à se développer, ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles aux jeunes générations.
Aujourd’hui, on dénombre environ 5 000 haenyeo à Jeju, dont 85 % ont plus de 60 ans. En voie de disparition, ces femmes de la mer sont devenues une fierté locale, un symbole d’autonomie et de courage. Leur savoir-faire ancestral a été reconnu au niveau mondial : le 1er décembre 2016, leur activité a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.
Les Haenyeo par le photographe Hyung S. Kim
Fasciné par la vie et l’histoire des haenyeo, le photographe Hyung S. Kim a choisi de consacrer plusieurs années à immortaliser la force et la beauté de ces femmes aujourd’hui devenues grand-mères, mais toujours actives. Il les photographie en studio, individuellement, devant un fond blanc. Mais plutôt que de les faire poser, il les saisit à leur retour de plongée, encore marquées par l’effort. Essoufflées, les visages ridés, tachés de sel et burinés par les années, elles apparaissent dans toute leur vérité — dignes, fatiguées, puissantes.
Plus que n’importe quel documentaire, les portraits de Hyung S. Kim révèlent la dureté de leur labeur, la rudesse du quotidien, mais aussi une forme de grandeur silencieuse. Chaque détail compte : les traits du visage, les plis de leurs combinaisons, les outils rudimentaires qu’elles portent — tout raconte une histoire. Celle d’un engagement, d’une tradition, d’une vie passée à défier la mer.


Interview
Comment est née la série Haenyeo ?
En 2011, il y a six ans, j’ai rencontré des haenyeo pour la première fois sur l’île de Jeju. Elles étaient très différentes de l’image que je m’en faisais. Leur présence, leur force tranquille m’ont immédiatement captivé. J’ai eu envie de leur rendre hommage à travers mon travail photographique.
Pouvez-vous nous parler du déroulement du projet ?
Je vis à Séoul, et Jeju est assez éloignée. Pour mener ce projet à bien, j’ai décidé de m’installer sur l’île pendant un an, afin d’éviter les allers-retours et de m’immerger dans leur univers.
Sur place, plusieurs difficultés se sont présentées. D’abord, la météo de Jeju est imprévisible. Les haenyeo ne plongent qu’une dizaine de jours par mois, selon les conditions de mer. Ensuite, avec l’afflux touristique, elles se font plus discrètes, plus méfiantes. Il a donc fallu du temps pour établir la confiance, et les convaincre de venir poser devant un simple tissu blanc que j’avais tendu en bord de mer.
Le vent, le froid, la fatigue — tout rendait les prises de vue plus complexes. La plupart des portraits ont d’ailleurs été réalisés en hiver, juste après leur journée de plongée.
Ces femmes pêchent encore en apnée, comme elles l’ont toujours fait. Elles plongent plusieurs heures par jour, remontant à la surface les bras chargés de coquillages. C’est un travail extrêmement pénible, qu’elles pratiquent depuis l’enfance. Beaucoup souffrent de douleurs chroniques, de troubles auditifs, et prennent des analgésiques pour tenir le coup. Chaque plongée est une épreuve, un vrai combat. On dit qu’en apnée, elles se tiennent sur le fil ténu qui sépare la vie et la mort. Et le regard qu’elles portent sur le monde après une longue session sous l’eau… c’est quelque chose que je n’ai jamais vu ailleurs.
C’est précisément ce que je voulais capturer.
Pourquoi avoir choisi de les photographier sur fond blanc ?
Quand je les ai vues sortir de l’eau, j’ai été frappé par leur apparence. Elles étaient épuisées, mais une forme de dignité, presque de majesté, se dégageait d’elles. Il y avait là une puissance silencieuse que je voulais absolument transmettre.
Plutôt que de les photographier dans leur environnement, j’ai voulu me concentrer uniquement sur elles. Sur leur visage, leur corps, leur posture. C’est pourquoi j’ai choisi un fond neutre, un tissu blanc, pour faire disparaître le contexte et laisser toute la place au portrait.
Pour moi, c’était essentiel de les photographier après leur travail. C’est à ce moment-là qu’elles sont les plus vraies, les plus touchantes, les plus fortes aussi.
Quel regard portez-vous sur Séoul ?
Séoul est la ville où je suis né et où j’ai grandi. C’est une ville fascinante, mais en constante mutation. Elle change très vite, parfois au point d’oublier son propre passé. Ce que j’aimerais, c’est pouvoir garder une trace de ce qui disparaît.
Il y a encore des endroits où le passé résiste, comme le quartier d’Anguk, avec ses petites ruelles anciennes. Ce sont ces espaces de mémoire que j’essaie de préserver, à ma manière, à travers mes images.